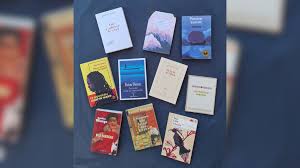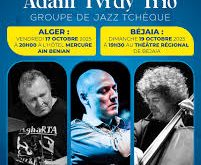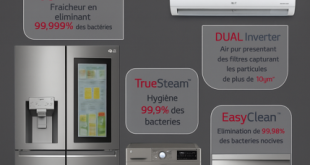La Mauricienne Nathacha Appanah, les Sénégalais David Diop et Fatou Diome, ou encore les Américains Jesmyn Ward et Percival Everett font partie des têtes d’affiche de la rentrée littéraire africaine 2025. À leurs côtés se font entendre d’autres voix, des voix montantes ou pas suffisamment mises en avant telles que le Soudanais Abdelaziz Baraka Sakin, le Nigérian Teju Cole ou encore le primo-romancier Mathieu Niango. Voici une liste de dix incontournables de la rentrée, représentatifs de la sensibilité littéraire des « continents noirs ».
► La nuit au cœur de Nathacha Appanah
La nuit au cœur (Gallimard) est le neuvième roman de la Mauricienne Nathacha Appanah. C’est un livre coup de poing où la parole vient se fracasser contre « l’impossibilité du langage », ouvrant des brèches dans les ténèbres de l’âme humaine. Son thème : le féminicide. Le récit entrelace trois histoires de violence conjugale : Chahinez, Algérienne de 31 ans, brûlée vive par son mari en pleine rue près de Bordeaux en 2021 ; Emma, la cousine de l’auteure qui avait le même âge que Chaninez en 2000 quand elle a été écrasée volontairement par son mari avec sa voiture à l’île Maurice ; et la propre histoire de violences conjugales dont Natacha Appanah fut victime et qui ont failli la consumer. Dans le roman, les trois destins s’entremêlent, révélant un engrenage meurtrier dans lequel la nuit noire prend la place de l’amour. Faire l’œuvre littéraire pour sonder l’énigme du passage à l’acte, telle est l’ambition de l’écrivaine dans ces pages. « C’est un livre que j’ai eu le privilège d’écrire, parce que je suis là », a-t-elle confié.
► L’homme qui lisait des livres de Rachid Benzine
La littérature peut-elle conjurer la mort et l’oubli des vivants ? C’est la question qui hante le lecteur de L’homme qui lisait des livres (Julliard), le nouveau titre sous la plume du Marocain Rachid Benzine. C’est le sixième roman de cet auteur qui s’est d’abord fait connaître comme historien et islamologue. Le récit est campé ici au milieu des gravats et du chaos qui règne à Gaza sous les bombes. Son héros Nabil, né en 1948, l’année de la Nakba, est libraire dans la ville palestinienne meurtrie. Entouré de ses livres, le vieil homme attend qu’une âme charitable s’arrête dans sa librairie et vienne lui prêter l’oreille, car il a tant de choses à dire au monde. Quand un photographe pousse ce qui reste de la porte et lui pointe l’objectif, soucieux d’immortaliser cette scène invraisemblable de l’homme qui lit alors que le monde s’effondre autour de lui, Nabil lui raconte la tragédie interminable de son peuple, ses propres drames, mais surtout la leçon des livres dans lesquels il a puisé son courage et sa résistance face aux agressions infinies de l’Histoire.
► Vibrato de Teju Cole
« Les feuilles sont noires et lustrées et des fleurs mourantes émane une senteur qui pourrait être celle du jasmin. » Ainsi commence Vibrato (Zoë) du Nigérian Teju Cole. L’ouvrage, traduit de l’anglais par Serge Chauvin, n’est pas tout à fait un roman, même si une mince ligne narrative traverse ses 250 pages, disparaît, revient, comme le thème dans une œuvre musicale.
Le thème de Vibrato, c’est quelques mois dans la vie du protagoniste, Tunde. Ce dernier est le double de l’auteur : tout comme Cole, il est écrivain, critique d’art, photographe et last but not least professeur de « creative writing » dans une université américaine. Le livre s’ouvre sur une séance de photos en plein air interrompue par le propriétaire des lieux. On le voit ensuite s’acquitter de ses devoirs professoraux, avant de s’engager dans une promenade dans le Maine pour chiner chez les antiquaires. Tunde y est accompagné de sa compagne de Sadako. Leurs difficultés conjugalement son évoquées en passant…
La narration est fluide. Le récit des événements de la vie professionnelle et personnelle de Tunde est entrecoupé de commentaires, de digressions sur l’art, l’histoire, le pillage colonial des œuvres d’art, mais aussi des expériences de racisme puisées dans le vécu de l’auteur. À mi-chemin entre autofiction et méditation, ces pages se lisent comme un long essai qui invite le lecteur à réfléchir sur le monde comme il va, sur ses heurs et malheurs, sans passer par les conventions romanesques : intrigue, personnages, psychologie… Vibrato renouvelle la narration littéraire, son format, son architecture. Attention, chef-d’œuvre !
► Aucune nuit ne sera noire de Fatou Diome
Aucune nuit ne sera noire (Albin Michel) est le septième roman de la grande Fatou Diome. La romancière sénégalaise, qui s’était fait connaître en 2003 avec son inoubliable Le Ventre de l’Atlantique, renoue avec sa veine océane à travers son nouveau récit qui ressuscite la figure inoubliable et ô combien attachante d’un grand-père, pêcheur dans le Saloum.
Fatou Diome carbure à l’émotion. Son nouveau roman ne déroge pas à la règle. Avec nostalgie et tendresse infinie, elle brosse le portrait intime de ce grand-père courage auprès duquel la petite Fatou a appris l’art de vivre, en se plaçant toujours au-dessus du tumulte des vagues qui viennent s’écraser sur le sable du vivant. Bonjour profondeur et tristesse !
► Où s’adosse le ciel de David Diop
En l’espace de deux romans, le Sénégalais David Diop s’est hissé au rang des grandes plumes des lettres africaines. Ses lecteurs ne peuvent oublier sa narration empreinte d’humanité et de puissance imaginative, qui a fait la force de Frère d’âme. Ce premier roman a fait connaître ce romancier bourré de talents.
Où s’adosse le ciel (Julliard) est le titre du nouveau roman que l’écrivain vient de faire paraître. Puisant son inspiration dans l’histoire et les traditions narratives africaines, Diop trace dans ces pages le parcours d’un certain Bilal Seck voguant entre l’Égypte antique et le Sénégal du XIXe siècle, où se déroule l’action du roman. Le protagoniste est bloqué à La Mecque où il achève son pèlerinage et où sévit une épidémie de choléra. Ses compagnons de route l’abandonnent, craignant qu’il ait été contaminé. Or, Bilal, qui est griot, est porté par un imaginaire transmis par la grande chaîne de la parole qui le relie à ses ancêtres. Sa survie dépend de sa capacité de faire sens des signes que lui adresse le passé antique où s’enracine l’énigme de ses origines.
Un récit astucieux, intelligent qui relève à la fois de l’épopée et du conte philosophique voltairien.
►James de Percival Everett
Percival Everett est un nom incontournable des lettres africaines-américaines. Il est directeur du département des lettres à la Southern California University, aux États-Unis, et romancier particulièrement fécond, avec plus d’une vingtaine de romans à son actif. Son dernier roman James (Belfond), qui vient d’être traduit en français par Anne-Laure Tissut, a reçu en 2024 le National Book Award, puis le prix Pulitzer de la fiction en 2025.
James est l’exemple même du roman postmoderne marqué par le mimétisme ironique, la parodie ou encore la métafiction. Roman parodique, James réécrit Les Aventures de Huckleberry Finn, le grand classique des lettres américaines. Récit picaresque de Mark Twain, ce roman raconte l’histoire du personnage éponyme : Huck est un jeune vagabond qui a fugué de chez lui pour échapper aux violences de son père. Son chemin croise celui d’un esclave noir, dénommé Jim, et, ensemble, ils feront les 400 coups, en particulier au fil des eaux du Mississippi. Dans ce roman écrit avec la sensibilité du XIXe siècle, l’esclave noir devient compagnon de route, mais n’en reste pas moins « propriété ». C’est ce rapport de force que Percival Everett réimagine et bouscule dans sa version moderne, en donnant la parole à James.
Les Aventures de Huckleberry Finn, racontées dans la perspective de l’homme noir, font apparaître les contradictions et les apories de la société américaine, qui a tardé à reconnaître l’humanité de l’Autre. Mais le code a changé, comme en témoigne James, dans les pages duquel Huck et James sont ensemble dans la lutte prométhéenne de l’humanité pour vivre libre en choisissant son destin.
► Passagères de nuit de Yanick Lahens
« Je suis venue au monde à la tombée de la nuit » : ainsi parle Elizabeth, protagoniste de Passagères de nuit (Sabine Wespieser), le nouveau roman de Yanick Lahens. Le titre renvoie aux bateaux négriers, dont le roman évoque l’effroyable réalité ainsi que les convulsions de l’histoire de Haïti pendant la colonisation et après l’indépendance.
Grande dame des lettres haïtiennes, Yanick Lahens s’est fait connaître en publiant il y a 25 ans Dans la maison du père, son tout premier roman : un récit poignant de fin d’adolescence d’une jeune fille grandissant dans une famille de grande bourgeoisie à Port-au-Prince dans les années 1940. Depuis, la question de liberté a été au cœur de l’œuvre littéraire de Lahens. Son nouveau roman ne déroge pas à la règle.
À travers ses protagonistes, qui ont pour nom Elizabeth et Régina, le nouveau roman de l’Haïtienne brosse le portrait en miroir de deux femmes volontaires engagées dans des trajectoires d’émancipation parallèles. Née à La Nouvelle-Orléans, Elizabeth doit fuir la ville clandestinement après avoir été victime de deux tentatives de viol par un homme puissant, devenant à son tour une « passagère de nuit ». Sa rencontre avec Régina, la solidarité des deux femmes qui se comprennent dans leur volonté de ne pas se soumettre, tracent la cartographie d’une résistance au féminin à la domination sociale.
► Le fardeau de Matthieu Niango
Normalien, agrégé de philosophie, Matthieu Niango livre avec Le fardeau un premier roman à la fois poignant et puissant. Ce roman raconte une enquête sur les origines où la quête familiale rejoint l’Histoire avec un grand « H ».
Tout commence dans un petit village de la Meuse où une vieille dame vient de mourir. Elle est la grand-mère de l’auteur-narrateur Niango, qui apprend à cette occasion que sa mère n’était pas la vraie fille de la défunte, mais sa fille adoptive. L’enquête extravagante dans laquelle le petit-fils entraîne alors sa mère révèle que celle-ci était née en pleine Seconde Guerre mondiale, dans un Lebensborn, quelque part en Belgique. Les Lebensborn étaient des maternités mises en place par Heinrich Himmler pour favoriser l’avènement d’une race de purs Aryens, appelée à dominer le monde pendant mille ans.
Pour les enquêteurs mère-fils, plus déroutante sera la découverte que la grand-mère biologique était une juive hongroise qui, peut-être pour sauver sa peau, avait accepté de concevoir sa fille avec un officier nazi. Ou était-ce par l’amour ? Or, quelles que furent ses motivations, pour le narrateur qui est lui-même métis – né d’une mère française et d’un père ivoirien –, cette généalogie est lourde à porter. Elle est lourde historiquement, moralement, psychiquement. Trouvera-t-il un chemin de pacification ? C’est ce que découvrira le lecteur en allant jusqu’au bout de ce livre quasi autofictionnel et construit comme un puzzle généalogique.
► Le corbeau qui m’aimait d’Abdelaziz Baraka Sakin
Avec sept romans et plusieurs recueils de nouvelles à son actif, le Soudanais Abdelaziz Baraka Sakin s’est imposé comme l’une des voix majeures de langue arabe. Emprisonné dans son pays pour ses écrits subversifs, puis contraint à l’exil, l’homme partage sa vie entre la France et l’Autriche. Il est traduit en français par Xavier Luffin, aux éditions Zulma qui publient cette année son quatrième roman, intitulé joliment Le corbeau qui m’aimait. Ce roman est peut-être un tournant dans la carrière littéraire de l’auteur, qui a mis de côté la thématique de la politique pour raconter les tourments et la nostalgie des Soudanais exilés.
Dans les pages de ce bref roman de 176 pages, Sakin suit l’odyssée des migrants soudanais en Europe, négociant la périlleuse Route des fourmis avant d’échouer dans la « jungle de Calais ». Ils rêvent d’aller en Angleterre, quitte à traverser la Manche en montgolfière. C’était aussi le rêve d’Adam, un des plus vieux pensionnaires de la jungle, qui a tout connu : les agressions policières, les moqueries des habitants, le désespoir. Il passait son temps à parler aux corbeaux avec lesquels il partageait sa maigre ration, en attendant de se lancer, lorsque l’opportunité se présentera, dans une énième traversée dans l’espoir d’atteindre son pays de rêve. Le destin tragique de ce migrant, que ses amis de la jungle appelaient affectueusement Adam l’Ingliz, est le sujet de ce nouveau roman de Baraka Sakin, à la fois poignant et engagé.
► Nous serons tempête de Jesmyn Ward
Nous serons tempête (Belfond) est le cinquième titre publié en français de l’Américaine Jesmyn Ward, double lauréate de National Book Award. Traduit de l’anglais par Charles Recoursé, le roman nous plonge au sein de la tragédie de l’esclavage. Annis est encore un enfant quand sa mère est revendue par le propriétaire de la plantation. L’adolescente ne peut désormais compter que sur les enseignements de sa mère. Elle lui avait appris à se défendre dès son très jeune âge contre les appétits et les agressions du monde blanc, qui a droit de vie et de mort sur elle. Annis peut compter aussi sur sa grand-mère Aza, qui fut guerrière dans l’armée des rois de Dahomey et dont l’esprit continue à la guider. Les armes et les sagesses suffiront-elles à protéger Annis et l’empêcher de sombrer ? Rien n’est moins sûr. Revendue à son tour, elle est exposée à tous les dangers pendant sa terrible marche vers les plantations de La Nouvelle-Orléans.
Partagée entre réalisme social et échappée poétique, l’écriture de Jesmyn Ward n’est pas sans rappeler la gravitas tragique des romans d’une certaine Toni Morrison.
T. C.
 INTERFIL ALGERIE Soyez le premier informé
INTERFIL ALGERIE Soyez le premier informé